La fugue
Santiago Quesada Polo
Présentation
A cette époque (années 60),
j’habitais dans un petit village proche de Grenade avec mes parents, frères et
sœurs. Nous étions une famille très humble et les voyages étaient plus que rares.
Je ne sais pourquoi, mais j’ai toujours été attiré par la mer, synonyme de
mille aventures. La mer était proche dans mon imaginaire et lointaine dans la
distance, alors que quelques dizaines de kilomètres seulement nous séparaient.
Le récit qui suit relate la seule vraie aventure de ma vie.
Récit
Maman m’a toujours dit que
j’avais été fabriqué dans un champ de canne à sucre, à quelques encablures de
la mer, dans la vallée de Motril, au sud de Grenade.
Je venais d’avoir quatorze ans,
en ce début d’août 1968. Ce matin de dimanche, Il faisait déjà chaud, très
chaud. Après avoir pris mon café au lait, j’enfourchai mon vélo de course, en
réalité seul le guidon courbé justifiait la noble appellation, et son poids,
une vingtaine de kilos de fer rendait dure la pédale. Je criai à ma mère que
j’allai faire un tour. Je pris la petite
route, plutôt un chemin de terre poussiéreux, qui menait de mon village à
Grenade et pédalais allègrement, épris d’une d’euphorie que rien ne justifiait
si ce n’est l’insouciance de l’âge.
Quelques minutes après, j’arrivai
dans les faubourgs de Grenade. J’aperçu le panneau routier indiquant les 67
kilomètres de distance jusqu’à Motril, capitale de la Côte, comme elle s’était
autoproclamée.
A la vue du panneau que
j’associai à la mer, sans trop réfléchir, ce que je regretterai amèrement par
la suite, je filai sur la route nationale qui, d’après mes calculs, plus
qu’optimistes, devait me mener rapidement sur les bords de la Mare Nostrum.
Il était dix heures du matin, en
quelques secondes d’une inconscience parfaitement réfléchie et propre à mon
jeune âge, j’estimai qu’à une moyenne de 30 kilomètres l’heure, vers midi, je
gouterais aux plaisirs de la mer. Une
trempette d’une demi-heure, puis retour à la maison pour le déjeuner vers trois
heures. Ni vu, ni connu. Mes parents n’avaient nul besoin de connaître mon
petit périple de la matinée.
J’avais oublié simplement que le
parcours vers la mer, bien que descendant depuis Grenade, était tout de même
agrémenté de nombreuses côtes, que je trouvai par la suite particulièrement
pentues à mon goût.
Après une heure d’efforts et une
vingtaine de kilomètres parcourus, je m’arrêtai au bord de la nationale, à
Dúrcal, un petit village blanc blotti aux pieds de la Sierra Nevada, pour me
désaltérer dans une des nombreuses fontaines que l’on peut apercevoir dans tous
les villages d’Andalousie.
Il me restait quarante-sept
kilomètres encore pour réaliser ce fort désir de voir la mer et de m’y baigner.
Le compte n’y était pas. A ce rythme je ne serai jamais de retour à la maison
pour le repas de midi. Le bon sens, si j’en avais eu, m’aurait conseillé de
faire demi-tour, mais alors il n’y aurait pas eu d’histoire à raconter. Mais ce jour-là, le désir de goûter la mer si
proche n’eut pas grand mal à s’imposer à ma raison inexistante.
Je voyais déjà ma mère
s’inquiéter et mon père gronder de colère.
Je poursuivis donc mon histoire
et pédalait avec une espèce de rage. La sueur dégoulinait de partout,
s’imprégnait de la poussière des quelques camions que je croisai. La chaleur
croissante, les lèvres desséchées, la bouche pâteuse, le soleil éblouissant,
brouillaient ma vue. Et la faim !
Au détour d’une côte raide et
longue comme un jour sans pain, j’aperçus au loin la silhouette d’une jeune
fille qui marchait le long de la route et un peu plus loin, quelques roulottes
et des ânes. Arrivé à sa hauteur, elle
me fixa d’un regard curieux. C’était une
petite gitane d’une douzaine d’années, peut-être plus, très brune et avec de
longs cheveux qu’elle couvrait d’un foulard aux couleurs bariolées.
Je m’arrêtai, elle me sourit et
me demanda si je voulais un morceau de pain. J’acquiesçais. Elle me fit signe
de la suivre jusqu’aux roulottes où s’affairaient une famille de gitans
saltimbanques qu’on appelait à l’époque, je ne sais pourquoi, los húngaros,
les hongrois. Une chèvre savante broutait quelques herbes solitaires. La
matriarche de la famille, une femme forte, avec une robe aux mille couleurs, le
visage ridé par mille soleils, m’offrit un morceau de pain avec du chorizo.
J’avalai en quelques secondes cette délice inattendue, sous le regard amusé de
la petite fille. Le patriarche, aux énormes favoris et au grand chapeau noir,
me tendit une gourde de vin que je n’osai refuser.
Je les remerciai puis repris mon
vélo. Je jetai un dernier regard à la petite gitane qui soudainement me sembla
d’une grande beauté, nimbée d’un mystère qui pendant longtemps me fit
rêver.
Quelques temps après, remontant
les petites caracoles de Vélez, à une quinzaine de kilomètres de Motril, la
faim me saisit de nouveau. Mes jambes flageolaient, mon corps mouillé par la
sueur, s’asséchait de l’intérieur. Puis, le miracle! Devant moi, à quelques
dizaines de mètres, un figuier, un magnifique, un merveilleux figuier, avec des
fruits abondants, à portée de ma main, que je m’empressai de cueillir et
d’engloutir avec la peau, même s’ils n’étaient pas tout à fait très mûrs. Ce fut le meilleur festin de ma vie.
Il était deux heures de
l’après-midi. Arrivé au sommet d’une colline, j’entrevis au loin, entre les
pins, le bleu intense de la mer. Au loin
se dandinait un petit voilier, toutes voiles déployées. La plage était déserte,
l’écume me caressa mes pieds. Débarrassé de mon short et de mon caleçon, je
m’élançai vers les vagues qui m’enlacèrent dans une étreinte légère et salée et
que j’embrassai de tout mon corps. Je goutai le bonheur comme un petit garçon
savoure un bonbon qu’il ne veut pas voir finir. Allongé sur le sable, le
soleil, insouciant, caressait ma peau. Il était trois heures de l’après-midi.
Que faire ? Je n’avais pas une peseta en poche. A 70 kilomètres de ma
maison. Et surtout affamé.
Le poids de ma triste condition
s’abattit dans toute sa cruelle réalité.
Alors, je me souvins que nous
connaissions une famille qui vivait à Torrenueva, un petit village de pêcheurs
proche de Motril. Prudencia m’aperçut sur la porte d’entrée de sa petite maison
chaulée plantée à même la plage et me sourit. Elle n’avait pas l’air surprise.
Les odeurs d’une paella s’engouffra, tel un tsunami dans mes narines
desséchées. Elle m’embrassa puis posa une énorme et belle assiette de riz doré
sur la vieille table en bois. A bouchées doubles, j’expédiai mon assiette tout
en racontant mon périple à moitié avorté.
Je passais le reste de
l’après-midi allongé dans la minuscule chambre de son fils Manolo, qui avait
mon âge, en écoutant des chansons des Bee Gees sur sa radiocassette.
Prudencia appela mes parents et
les rassura sur mon sort.
Je passais les trois plus beaux
jours ma vie au bord de la mer avec Manolo, goûtant aux savoureux plats de
Prudencia et aux longues siestes musicales.
Epilogue
Je retournai à Grenade en
autocar, le vélo arrimé sur le toit.
A la maison, maman m’embrassa longuement. Papa, convaincu que j’avais fugué, m’administra une solide correction que, seuls les plus de 50 ans, peuvent imaginer.








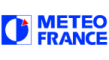





Avr 5 2020
Écho Voile N° 2/2020 : Carry Voile à la cape, mais toujours sur le pont de l’amitié
La fugue
Santiago Quesada Polo
Présentation
A cette époque (années 60), j’habitais dans un petit village proche de Grenade avec mes parents, frères et sœurs. Nous étions une famille très humble et les voyages étaient plus que rares. Je ne sais pourquoi, mais j’ai toujours été attiré par la mer, synonyme de mille aventures. La mer était proche dans mon imaginaire et lointaine dans la distance, alors que quelques dizaines de kilomètres seulement nous séparaient. Le récit qui suit relate la seule vraie aventure de ma vie.
Récit
Maman m’a toujours dit que j’avais été fabriqué dans un champ de canne à sucre, à quelques encablures de la mer, dans la vallée de Motril, au sud de Grenade.
Je venais d’avoir quatorze ans, en ce début d’août 1968. Ce matin de dimanche, Il faisait déjà chaud, très chaud. Après avoir pris mon café au lait, j’enfourchai mon vélo de course, en réalité seul le guidon courbé justifiait la noble appellation, et son poids, une vingtaine de kilos de fer rendait dure la pédale. Je criai à ma mère que j’allai faire un tour. Je pris la petite route, plutôt un chemin de terre poussiéreux, qui menait de mon village à Grenade et pédalais allègrement, épris d’une d’euphorie que rien ne justifiait si ce n’est l’insouciance de l’âge.
Quelques minutes après, j’arrivai dans les faubourgs de Grenade. J’aperçu le panneau routier indiquant les 67 kilomètres de distance jusqu’à Motril, capitale de la Côte, comme elle s’était autoproclamée.
A la vue du panneau que j’associai à la mer, sans trop réfléchir, ce que je regretterai amèrement par la suite, je filai sur la route nationale qui, d’après mes calculs, plus qu’optimistes, devait me mener rapidement sur les bords de la Mare Nostrum.
Il était dix heures du matin, en quelques secondes d’une inconscience parfaitement réfléchie et propre à mon jeune âge, j’estimai qu’à une moyenne de 30 kilomètres l’heure, vers midi, je gouterais aux plaisirs de la mer. Une trempette d’une demi-heure, puis retour à la maison pour le déjeuner vers trois heures. Ni vu, ni connu. Mes parents n’avaient nul besoin de connaître mon petit périple de la matinée.
J’avais oublié simplement que le parcours vers la mer, bien que descendant depuis Grenade, était tout de même agrémenté de nombreuses côtes, que je trouvai par la suite particulièrement pentues à mon goût.
Après une heure d’efforts et une vingtaine de kilomètres parcourus, je m’arrêtai au bord de la nationale, à Dúrcal, un petit village blanc blotti aux pieds de la Sierra Nevada, pour me désaltérer dans une des nombreuses fontaines que l’on peut apercevoir dans tous les villages d’Andalousie.
Il me restait quarante-sept kilomètres encore pour réaliser ce fort désir de voir la mer et de m’y baigner. Le compte n’y était pas. A ce rythme je ne serai jamais de retour à la maison pour le repas de midi. Le bon sens, si j’en avais eu, m’aurait conseillé de faire demi-tour, mais alors il n’y aurait pas eu d’histoire à raconter. Mais ce jour-là, le désir de goûter la mer si proche n’eut pas grand mal à s’imposer à ma raison inexistante.
Je voyais déjà ma mère s’inquiéter et mon père gronder de colère.
Je poursuivis donc mon histoire et pédalait avec une espèce de rage. La sueur dégoulinait de partout, s’imprégnait de la poussière des quelques camions que je croisai. La chaleur croissante, les lèvres desséchées, la bouche pâteuse, le soleil éblouissant, brouillaient ma vue. Et la faim !
Au détour d’une côte raide et longue comme un jour sans pain, j’aperçus au loin la silhouette d’une jeune fille qui marchait le long de la route et un peu plus loin, quelques roulottes et des ânes. Arrivé à sa hauteur, elle me fixa d’un regard curieux. C’était une petite gitane d’une douzaine d’années, peut-être plus, très brune et avec de longs cheveux qu’elle couvrait d’un foulard aux couleurs bariolées.
Je m’arrêtai, elle me sourit et me demanda si je voulais un morceau de pain. J’acquiesçais. Elle me fit signe de la suivre jusqu’aux roulottes où s’affairaient une famille de gitans saltimbanques qu’on appelait à l’époque, je ne sais pourquoi, los húngaros, les hongrois. Une chèvre savante broutait quelques herbes solitaires. La matriarche de la famille, une femme forte, avec une robe aux mille couleurs, le visage ridé par mille soleils, m’offrit un morceau de pain avec du chorizo. J’avalai en quelques secondes cette délice inattendue, sous le regard amusé de la petite fille. Le patriarche, aux énormes favoris et au grand chapeau noir, me tendit une gourde de vin que je n’osai refuser.
Je les remerciai puis repris mon vélo. Je jetai un dernier regard à la petite gitane qui soudainement me sembla d’une grande beauté, nimbée d’un mystère qui pendant longtemps me fit rêver.
Quelques temps après, remontant les petites caracoles de Vélez, à une quinzaine de kilomètres de Motril, la faim me saisit de nouveau. Mes jambes flageolaient, mon corps mouillé par la sueur, s’asséchait de l’intérieur. Puis, le miracle! Devant moi, à quelques dizaines de mètres, un figuier, un magnifique, un merveilleux figuier, avec des fruits abondants, à portée de ma main, que je m’empressai de cueillir et d’engloutir avec la peau, même s’ils n’étaient pas tout à fait très mûrs. Ce fut le meilleur festin de ma vie.
Il était deux heures de l’après-midi. Arrivé au sommet d’une colline, j’entrevis au loin, entre les pins, le bleu intense de la mer. Au loin se dandinait un petit voilier, toutes voiles déployées. La plage était déserte, l’écume me caressa mes pieds. Débarrassé de mon short et de mon caleçon, je m’élançai vers les vagues qui m’enlacèrent dans une étreinte légère et salée et que j’embrassai de tout mon corps. Je goutai le bonheur comme un petit garçon savoure un bonbon qu’il ne veut pas voir finir. Allongé sur le sable, le soleil, insouciant, caressait ma peau. Il était trois heures de l’après-midi. Que faire ? Je n’avais pas une peseta en poche. A 70 kilomètres de ma maison. Et surtout affamé.
Le poids de ma triste condition s’abattit dans toute sa cruelle réalité.
Alors, je me souvins que nous connaissions une famille qui vivait à Torrenueva, un petit village de pêcheurs proche de Motril. Prudencia m’aperçut sur la porte d’entrée de sa petite maison chaulée plantée à même la plage et me sourit. Elle n’avait pas l’air surprise. Les odeurs d’une paella s’engouffra, tel un tsunami dans mes narines desséchées. Elle m’embrassa puis posa une énorme et belle assiette de riz doré sur la vieille table en bois. A bouchées doubles, j’expédiai mon assiette tout en racontant mon périple à moitié avorté.
Je passais le reste de l’après-midi allongé dans la minuscule chambre de son fils Manolo, qui avait mon âge, en écoutant des chansons des Bee Gees sur sa radiocassette.
Prudencia appela mes parents et les rassura sur mon sort.
Je passais les trois plus beaux jours ma vie au bord de la mer avec Manolo, goûtant aux savoureux plats de Prudencia et aux longues siestes musicales.
Epilogue
Je retournai à Grenade en autocar, le vélo arrimé sur le toit.
A la maison, maman m’embrassa longuement. Papa, convaincu que j’avais fugué, m’administra une solide correction que, seuls les plus de 50 ans, peuvent imaginer.
By jean-pierre Montagnon • Historique Infos